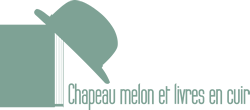Le boulevard Maurice Barrès a la particularité, comme les autres voies qui longent les bois de Paris, de n’être occupé que d’un côté. Seuls les numéros pairs ont ici droit de cité, et la majorité de leurs habitants jouissent d’une vue imprenable sur le Bois de Boulogne. Le week-end, de nombreuses familles se retrouvent au Jardin d’Acclimatation, à deux pas. Je me souviens de ce jardin comme si c’était hier. Les animaux de la ferme, le Dragon, le labyrinthe des glaces, la rivière enchantée… Quand mes parents me prévenaient, au début de la semaine, que nous nous y rendrions le dimanche suivant, je ne pensais plus qu’à cela. Aux manèges. Aux miroirs déformants. A la maison inversée… A tel point que je devenais obnubilée par ce lieu. Mais avant cela, il fallait aller voir la tante Denise. C’était une sorte de marché que j’avais conclu, à 8 ans, avec mes parents, las de me voir piquer des colères chaque fois que le nom de ma grand-tante était prononcé.
Je détestais aller dans son appartement, situé dans l’un des immeubles les plus anciens et défraîchis du boulevard. Les murs décrépis, les objets recouverts de poussière, les tables ornées de napperons en dentelle auxquels il était interdit de toucher… Tout produisait sur moi une intense sensation de malaise. Je parvenais à me contenir un temps puis, généralement au bout d’une heure, je me mettais à tanner mes parents et finissais par hurler.
Cela devait faire 15 ans que je n’avais pas remis les pieds à Neuilly. La dernière fois, c’était à la mort de Denise. Ma mère avait insisté pour que je l’accompagne dire adieu à cette tante qu’elle avait connue drôle et fantasque, et que je n’avais vu que rabougrie et mutique.
Lorsque je réalisai que le cabinet de Jean-Philippe Perche se trouvait dans le quartier où j’avais passé une partie de mon enfance, le dernier souvenir de ma tante, étendue sur son lit une place dans sa robe en velours noir, les yeux fermés, me traversa l’esprit. Mais je ne prêtai pas plus d’attention que cela à la coïncidence. Ce n’est qu’en arrivant devant le numéro 60 et en voyant les façades des constructions voisines que je reconnus l’endroit : l’immeuble, désormais flambant neuf, était difficilement identifiable et pourtant, c’était bien celui de Denise ! Un peu sonnée, je me dépêchai malgré tout de pénétrer dans le hall. Je trouvai sans peine la lumière et sursautai devant les changements qui y avaient été apportés. Autrefois pièce minuscule aux murs lambrissés, l’entrée avait pris des dimensions impressionnantes et était désormais entièrement parée de marbre. Mais malgré la beauté du lieu, la sensation de malaise que je croyais disparue depuis 15 ans refit brutalement son apparition. Etait-ce l’appréhension de participer à ma première séance d’hypnose ?
A l’époque, je voulais arrêter de fumer et j’avais déjà tout essayé – sans succès. Un an auparavant Marlène, une collègue de l’agence, m’avait parlé de l’hypnose, qui faisait des miracles, selon elle. Un peu effrayée par l’idée, je n’avais pas donné suite, Marlène avait quitté l’agence pour d’autres horizons, le temps était passé… et je fumais toujours. Alors un soir, prise d’une nouvelle quinte de toux, je décidai de jeter mon paquet et d’appeler l’hypnotiseur dont j’avais conservé la carte.
Je me retrouvai donc trois mois plus tard – M. Perche était un hypnotiseur à succès – dans l’immeuble de ma tante Denise. Lorsque je sonnai à l’interphone, après ce que j’espérais être ma dernière cigarette, une voix féminine m’indiqua le 3e étage. Ce n’est qu’en arrivant sur le palier et en voyant que la porte de gauche était entrouverte qu’une angoisse sourde s’empara de moi. Elle s’amplifia à mesure que je m’approchai de l’appartement dans lequel j’avais passé, enfant, tant d’après-midi.
Je poussais la porte et je reconnus tout. Le papier peint jauni avait été bazardé, la vieille moquette retirée, les meubles changés, mais c’était bien la même petite entrée donnant sur un large couloir, le même double séjour où une jeune femme, blouse blanche et chignon serré, m’invita à entrer. Alors que j’étais assise tout au bord d’un fauteuil, dans cette grande pièce baignée de lumière, chaque minute qui passait augmentait mon mal-être. J’avais le souffle de plus en plus court. Un mal de crâne s’empara de moi et mes mains devinrent moites, presque mouillées. Et ce Jean-Philippe Perche qui n’arrivait pas… Au bout de 10 minutes d’attente, au bord du supplice, je me levai d’un bond, traversai le couloir, et claquai la porte sans un mot. Je dévalai les escaliers et me retrouvai à l’air libre. Je donnerais beaucoup pour revivre la sensation de plénitude de ce moment. Un mélange d’extrême bien-être et de soulagement, comme si, en m’enfuyant de là, j’avais échappé à quelque chose.
Je ne sais pas ce qui m’attendait là-bas, et je ne le saurai jamais. En revanche, je n’ai plus jamais retouché à une cigarette de toute ma vie.
Bérengère de Chocqueuse